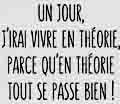
L’historiographie contemporaine n’en finit de revisiter l’histoire du mouvement ouvrier. Elle tente d’échapper avec plus ou moins de bonheur à la doxa marxiste. Bien des événements sont encore recouvert d’une couche d’interprétation qui relève le plus souvent d’une lecture mythologisante.
Dans le cas qui nous intéresse, la livraison de début 2007 de la Revue d’histoire moderne et contemporaine [1] en révisant la version romanesque et eschatologique de l’affaire des destructions des machines en Angleterre du début du XIX° siècle nous donne des matériaux pour réfléchir à la place que prirent les ouvriers dans la construction du mouvement social des années 1870 puis de l’anarchisme particulièrement jusqu’à la guerre de 1914.
Dans cet article, Philippe Minard fait apparaître clairement que ce qui heurte les ouvriers tisserands et assimilés en révolte ce n’est pas tant la machine en tant que telle mais ce qu’elle entraîne au niveau de la modification, du changement profond de l’organisation sociale.
Eric J. Hobsbawm avait déjà dans un article déjà ancien mais qui vient d’être republié [2] démontré que le bris de machine était une forme de négociations sociale particulièrement violente et tout aussi efficace, qui si elle touchait les machines pouvait tout aussi bien être appliqué contre les arbres de la propriété du patron qui se trouvaient alors couchés par terre.
C’est la systématisation de cette pratique, son extension et sa réclamation d’un leader, un certain Ned Ludd [3] qui auraient fait la célébrité d’un mouvement dont l’origine économique est à chercher avant tout dans le blocus militaire [4] dont souffrait l’Angleterre à ce moment là.
En introduisant des machines performantes le patronat anglais bouleversait, cassait la hiérarchie interne de la classe ouvrière. Cette hiérarchie échappe souvent à ceux qui étudient ce domaine, car elle est rarement explicite, mais toujours implicite. Il suffit d’assister à une réunion d’ouvriers sur un chantier pour savoir qui est quoi et en fonction de quoi ils parlent.
Revenons à la définition de base, l’ouvrier. Un dictionnaire étymologique va commencer par donner une explication contemporaine du mot, est ouvrier celui qui exécute pour le compte d’autrui, moyennant salaire, un travail manuel, puis à fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la notice apparaît la notion de travail bien fait, puis le mot « œuvre » prends sa place : C’est à l’oeuvre que l’on connaît l’ouvrier.
Depuis les temps les plus reculés, pour être reconnu par ses pairs, l’ouvrier exécute un chef d’œuvre. C’est cette capacité de faire qui lui donne son statut, c’est la complexité de cette œuvre qui le met à la place qui lui revient dans la hiérarchie ouvrière. Pour cela il a du faire un apprentissage long et souvent pénible, mais d’une rare complexité. Il est important de s’arrêter sur cette période cruciale pour l’ouvrier. Le début de l’apprentissage est le même dans toute les professions, balayage, petites courses, transport de matériau. C’est le temps nécessaire à la fois pour se faire à la dureté du travail et en même temps c’est un temps d’observation, où les anciens se font une idée sur la place que le nouveau va pouvoir tenir dans l’équipe. Il ne faut pas se cacher que cela peut aussi être le temps des vexations. Puis de fil en aiguille, la participation de l’apprenti à l’œuvre va devenir plus importante jusqu’au jour où on lui demandera de tracer une pièce. C’est à ce moment là que l’apprentissage réel commence. Dans tous les métiers qui « tracent » revient, comme un leitmotiv, le dicton disant qu’un plan bien fait c’est la moitié du travail exécuté. Pour savoir tracer, il faut d’abord avoir compris ce qu’il faut faire, puis savoir comment il faut faire, puis enfin on trace. Ces trois périodes sont fondamentales. Il suffit que l’une d’entre elles n’ait pas été approfondie pour que malgré toute l’habileté de l’ouvrier, toutes les capacités de sa main, l’objet terminé ne puisse servir.
On a souvent parler de » l’aristocratie ouvrière en parlant des métallos ou des mineurs ». Voilà un concept qui est né au début des années 20 sous l’impulsion des idéologues communistes, soucieux qu’il étaient de faire oublier la vrai aristocratie sur laquelle ils n’avaient pas pu mettre la main, car celle-là réfléchissait par elle-même, habituée qu’elle était à concevoir et réaliser du début à la fin quoi que se soit. L’aristocrate ouvrier est celui qui transforme la matière première en produit finit. Les Compagnons du devoir, enfants des corporations d’antan font remonter leurs origines aux constructeurs du Temple de Salomon. Sans aller jusque là, le consensus en milieu ouvrier est de considérer le tailleur de pierre comme la clé de l’édifice social. Il est l’architecte des origines, c’est lui qui connaît le mieux le trait. Puis viennent, en conflit permanent entre eux pour la seconde place,le menuisier et le charpentier, puis le maçon puis les autres.
Si l’on conserve l’idée que l’aristocrate ouvrier est celui qui transforme la matière première en un produit fini, on trouve à côté de ces corps de métier du bâtiment, aussi bien des serruriers, des tisserands ou des tailleurs. Ce sont ces hommes qui, ayant l’habitude de réfléchir, furent les plus actifs dans la construction des organisation et syndicat anarchistes ou d’inspiration proche. Ce fut eux qui le jour ou il fallut prendre la production en main réorganiser la vie sociale qui en Espagne et ailleurs naturellement prirent les choses en main.
Ce sont eux qui dans les grands pays industriels payèrent le plus grand tribut à la taylorisation du travail. En découpant la tâche en partie distincte, le capital avait besoin d’une main d’œuvre interchangeable. Même si la technicité pouvait être grande, s’en était fini de l’œuvre en tant que reproduction du grand Tout. A partir de là ceux qui s’instituèrent l’avant-garde du prolétariat pouvaient enfin conduire la classe ouvrière vers des horizons glorieux sans craindre la présence de trublions qui prétendaient se passer de chefs.
Aujourd’hui se pose le problème de la capacité de prise en main en cas de crise révolutionnaire de la partie de la société sur laquelle nous anarchistes nous pourrions avoir prise. Il est une chose d’occuper le terrain, s’en est une autre de gérer le va et vient et l’activité quotidienne ou a moyen terme. On ne peut pas s’en tirer en spéculant sur la spontanéité du « peuple ». Ce serait laisser la place à d’autres qui « savent » ce qu’il faut faire.
La formation anarchiste du militant commence à mon avis par la prise de conscience que tout ce qu’il a appris jusqu’à présent relève de l’idéologie dominante, que ce soit d’un point de vue intellectuel ou technologique. Une décision en apparence technique cache la plupart du temps une vision particulière de la société. Il ne suffit pas pourtant d’avoir du sens politique pour faire des choix technologiques importants. La question de savoir comment se débarrasser de ce qu’on a appris sans jeter le bébé avec l’eau du bain n’est pas simple.
A partir de là un champ immense s’ouvre devant lui. Apprendre à produire à plusieurs dans le respect individuel n’est pas une chose innée ni quelque chose qui viendrait comme le saint esprit le lendemain de la révolution. Au matin de la dite révolution il faudra aller travailler comme toujours mais de manière différente, seront nous prêt alors ?
